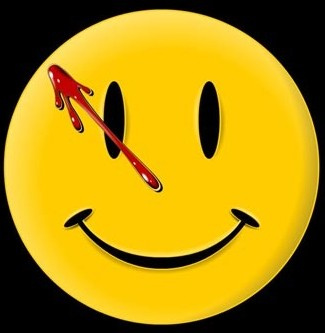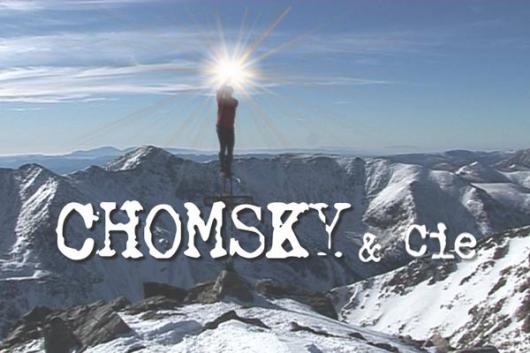Dix années ont passé depuis les onze semaines de frappes aériennes de l’OTAN sur la Serbie. A Belgrade, les traces des bombardements n’ont jamais totalement disparu.
C’est au coeur de cette capitale que L’Ambulance, premier long métrage de Goran Radovanovic a été tourné. A travers le quotidien d’un service ambulancier, ce film historique contemporain évoque le drame relatif aux profonds bouleversements subis par la société serbe depuis la chute du régime. Interview du réalisateur.
Haut Courant : Vous êtes déjà connu pour vos documentaires comme Chicken Elections. The Ambulance est votre premier long métrage. Depuis quand l’aviez vous en tête?
Goran radovanovic : Honnêtement, je ne sais pas. En fait, je sentais qu’il fallait que je rassemble et que je transforme les images de mes documentaires en un film de fiction rassemblant les mémoires collectives. J’ai donc commencé à écrire un script reflétant le « Zeit Geist » (ndlr : en Allemand : l’esprit du temps. Comprendre climat intellectuel) du drame politique et social serbe.
Pourquoi avoir suivi ce phénomène depuis un service ambulancier?
Sans doute parce que c’est de là qu’on peut voir le mieux la sensibilité et la fragilité de notre société.
Les personnages de votre film sont tristes, très affectés par les évènements de 1999, surtout les plus jeunes. Comment avez-vous réussi à orienter dans cette direction des enfants qui n’ont aucun souvenir de cette période?
Et bien peut-être parce que je suis un peu triste moi-même. Peut-être que c’est mon passé slave… C’est toujours difficile de diriger des enfants. Celui qui le fait doit très bien savoir comment les orienter. Pour cela, il faut avoir de la pratique, l’expérience de la vie. Je pense que je l’ai depuis que j’ai deux garçons.
Avez-vous réalisé un film politique?
Je voulais l’intituler « Un film historique et contemporain », comme il est dit dans le sous titre. Car l’histoire contemporaine est toujours politique! En ce sens, oui. Mais objectivement, j’étais plus focalisé sur l’esprit du temps que sur la politique.
Le film traite d’une période charnière pour la Serbie. Comment l’avez-vous vécue à l’époque?
Ce que j’ai pu ressentir en tant qu’être humain n’a pas d’importance. Mais en tant qu’artiste, j’étais vraiment heureux de pouvoir suivre l’un des plus importants évènements historiques, comme le fut la chute du régime par exemple. Bien sûr, je n’oublierai jamais la première bombe en Europe depuis la Seconde Guerre Mondiale : pendant 78 jours, l’OTAN a bombardé mon pays et ma ville.
Comment la nouvelle génération serbe considère t-elle ce passé?
Ce que je vois, à mon échelle, ce sont de jeunes gens frustrés, comme leurs parents : ils ne voient pas de futur pour eux. Lorsqu’on ne peut même pas imaginer de futur, comment considérer le passé ?
L’Ambulance (Hitna pomoc)
Serbie – 2009 – 1 h 24 mn –
Réalisation : Goran Radovanovic –
Scénario : Goran Radovanovic –
Interprétation : Vesna Trivalic, Natasa Ninkovic, Nenad Jezdic, Tanasije Uzunovic, Sonja Kolacaric, Jelena Stupljanin –