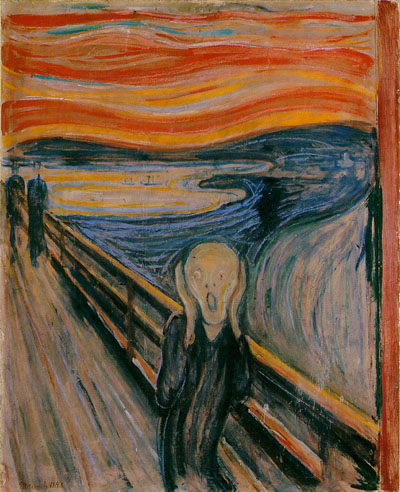Signée lundi par le président de la République après avoir été partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel jeudi, la loi sur la rétention de sûreté a été promulguée mardi 26 février. Des lieux d’enfermement à vie pour les criminels jugés dangereux seront donc créés.
Cette loi relative à « la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » compte 18 articles ainsi que la décision du Conseil constitutionnel.
Il est prévu l’ouverture de centres où les détenus les plus dangereux, auteurs de crimes avec circonstances aggravantes, pourront être enfermés à vie si ils sont toujours jugés dangereux au moment de l’expiration de leur peine de prison. Seuls sont concernés les criminels condamnés à 15 ans de prison et plus. Trois magistrats, réunis en commission, décideront le placement en rétention prévu pour un an et renouvelable indéfiniment.
Le Conseil Constitutionnel a refusé, jeudi, que la loi soit rétroactive. Saisie par les parlementaires socialistes, il a estimé que la rétention de sûreté « ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi » ou « pour des faits commis antérieurement » à cette publication. De ce fait, la loi ne produira ses premiers effets que dans quinze ans, puisqu’ elle concerne les détenus condamnés à 15 ans de prison minimum.
Cette décision n’a pas été du goût de Nicolas Sarkozy et l’a amené, vendredi, à demander au premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda, « de faire toutes les propositions » pour permettre « une application immédiate » de cette loi. Ce dernier « a accepté le principe d’une réflexion sur le problème de la récidive et de la protection des victimes mais il est bien évident qu’il n’est pas question de remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel » a expliqué un chargé de mission de la Cour de cassation. Le chef de l’Etat lui a demandé, lundi, de lui adresser ses propositions dans les trois mois.
En plus du refus sur la rétroactivité, le Conseil Constitutionnel a pointé du doigt les soins apportés aux détenus. Il faudra vérifier que le condamné a pu bénéficié, pendant son incarcération, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont il souffre.
Dans un entretien au journal Le Parisien-Aujourd’hui en France, publié mardi 26 février, Nicolas Sarkozy a réaffirmé sa volonté de rendre la loi rétroactive pour ne pas risquer de placer les criminels dans une situation d’inégalité. « On aura donc deux catégories de serial-violeurs : celui qui sera libre parce qu’il a été condamné juste avant la loi, et celui qui n’aura pas le droit de sortir parce qu’il a été condamné juste après, affirme-t-il. J’aimerais qu’on ne mette pas ce principe de la rétroactivité au service des criminels les plus dangereux ».
Selon un sondage Ifop pour Le Figaro, 80% des personnes interrogées approuvent la loi sur la rétention de sûreté. 64 % d’entre elles estiment qu’« il faut appliquer dès maintenant la rétention de sûreté à ces personnes pour éviter qu’elles récidivent ».