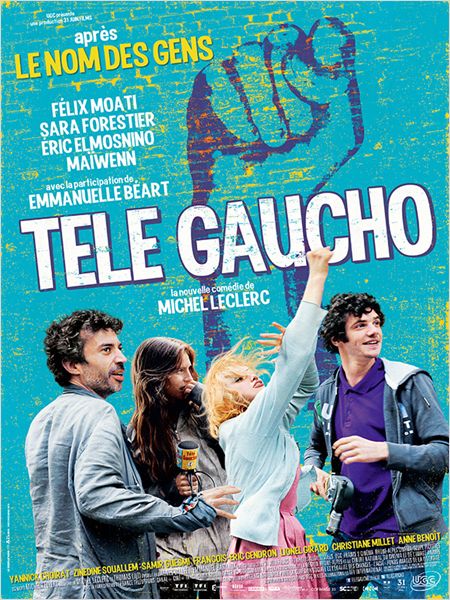Jean-Marc est un chef d’entreprise irascible, un père absent et un quadra dédaigneux sinon exécrable qui passe son temps à conduire trop vite, fumer comme un pompier et sortir tard la nuit – ou tôt le matin au choix. Bref, le Parisien carriériste et égoïste qui ne sert que ses intérêts. Alors qu’il doit se rendre au mariage de sa fille, un étrange concours de circonstances l’amène à croiser Marie, jeunette innocente pleine de principes, naïve et ingénue. Rapidement, elle croit voir en Jean-Marc le prince charmant qu’elle attendait depuis toujours : ce qu’elle ne sait pas encore, c’est que l’entreprise de Jean-Marc est responsable de la fermeture de l’usine familiale de son propre père.
« Il y en a qui ont des papas poules, moi j’ai un papa pute » [[Citation du film]]
Le pitch d’« Un prince presque charmant » prévisible et pas surprenant pour deux sous. Le côté comédie romantique n’est ni drôle ni passionné, seulement mielleux et cliché à souhait. Le schéma classique de l’homme à femme qui tombe amoureux en deux jours de la gentille niaise, est vu et revu. Aucune surprise pour ce film, sinon la médiocrité du ton et de l’histoire qui se délite peu à peu.
Vincent Perez en bobo odieux enchaine les gags ratés et des blagues qui ne font rire que lui. Un personnage caricatural et peu crédible qui gâche en tout point le talent du comédien.
Face à lui, une Vahina Giocante qui se veut irrésistible et joue de son charme pour interpréter une jeune idéaliste dont la crédulité tend rapidement à la bêtise. De rire nunuche en propos ringard, rien ne manque à son portrait de midinette amoureuse du grand méchant patron.
Un casting qui ne rattrape en rien le vide du scénario. Une heure et demie de film plat, creux et sans résonance qui n’enchante pas les salles. Enfin, le happy end prévisible de l’histoire vient clore cette fantastique production, qui n’apporte vraiment rien au paysage du cinéma français.