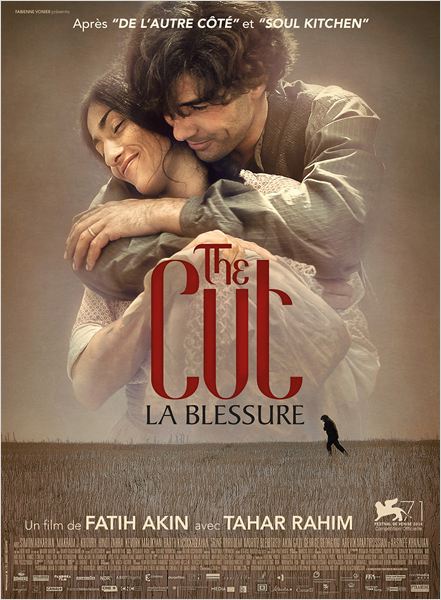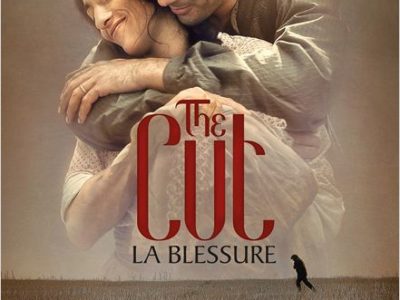Pour cette 40 ème édition de Cinemed, vous présentez Sibel en compétition long métrage, quel lien entretenez-vous avec le festival ?
Guillaume Giovanetti : C’est la troisième fois que nous sommes présents à Cinemed. La première fois c’était pour les bourses d’aide au développement avec Nour en 2006 et puis il y a trois ans pour Sibel. C’est le premier festival à nous avoir fait confiance et donné de l’argent pour un long métrage.
Çagla Zencirci : Cinemed nous a offert du soutien concret, financier pour un projet qu’on a pu développer. C’est excellent. On adore le festival parce qu’ils ont compris qu’un réalisateur, il faut qu’il mature. C’est en faisant des films qu’il acquiert de l’expérience. Quand vous recevez ce soutien, vous avez la liberté d’avancer en tant que réalisateur de manière indépendante.
Dans Sibel, vous traitez de l’exclusion d’une jeune femme muette et du manque de solidarité qu’elle subit au sein de son village en Turquie.
CZ : Avec ce personnage féminin rejeté par la société dans son intégralité, on voulait montrer le manque de solidarité entre les femmes, une entraide qui est absente. Il y a une vraie violence qui existe, une forme de compétition entre les femmes. A l’inverse, les deux personnages masculins que nous avons créés, n’interfèrent pas dans les décisions de notre personnage principal. Ils la laissent totalement libre de ses choix, mais la soutiennent dans le chemin qu’elle souhaite entreprendre. C’est ce genre d’homme que l’on veut voir dans la vraie vie.
Est-ce un film politique ?
CZ : Nous ne nous sommes jamais définis en tant que réalisateurs politiques. Notre vie est politique, on ne peut pas s’en débarrasser. Mais on a toujours utilisé la politique comme un décor. On a essayé de voir quels sont les effets des politiques menées sur nos personnages qui ont toujours été des exclus. Nous pensons que pour comprendre une société, il faut regarder les individus qui sont en marge. Là vous avez une idée très très claire de la société en elle même.
Est ce pour cela que vous avez réalisé Ata en 2008, pour montrer les difficultés d’intégration, en France cette fois ?
GG: Nous avions rencontré par hasard un homme de la communauté ouïghoure (turcophone musulmane de l’Ouest de la Chine) il y a une quinzaine d’années en France. Il était sans papiers, dans un processus d’exclusion avec des difficultés pour parler le français. Nous nous sommes inspirés de son histoire. Le film traite de la rencontre entre ce personnage ouïghour, qui n’a par défaut rien à voir avec la société française, et une jeune Turque venue en France pour des raisons amoureuses, pas du tout pour des raisons politiques ou économiques. Son fiancé la laisse au début du film, elle se retrouve seule dans un pays étranger complètement désemparée.
C’est cette marginalité commune qui va rapprocher les deux personnages ?
GG : Oui, c’est la rencontre de deux individus qui n’ont à priori rien en commun. Ils découvrent que leurs deux langues se ressemblent, qu’ils peuvent communiquer. On a cherché à illustrer les difficultés d’intégration d’un certain nombre de personnes qui viennent de l’extérieur de la société française. Cela donne naissance à une resolidarisation de personnes qui sont dans la même situation. On voit des groupes se créer, des manières de fonctionner autres qui n’ont vraiment rien à voir avec la société française. Ce qui va favoriser le communautarisme. C’est un court métrage réalisé il y a dix ans, mais il a encore une actualité énorme. Les choses n’ont pas beaucoup changé.
Votre prochain film sera-t-il de nouveau un projet en commun ?
CZ : Oui, cela fait 15 ans que l’on travaille ensemble. Nous n’avons pas d’oeuvre séparée. On a appris à travailler ensemble. On ne peut pas faire de films seuls, on ne sait pas comment faire.
GG : On a développé nos automatismes, nos façons de faire. C’est un ping pong permanent. Sibel c’est notre dixième film. On a un autre projet en Turquie, toujours avec un personnage féminin au centre, plus urbain, un peu plus âgé cette fois. Le film sera axé sur la question de la famille et du rôle de mère qui est prédestiné pour la femme. C’est un road movie à travers la Turquie, l’histoire d’une femme qui laisse ses enfants à son mari parce qu’elle n’en peut plus. Elle va rencontrer un transexuel qui va lui donner une autre définition de ce que c’est d’être une femme.
Est-ce une manière d’interroger les représentations de genre ?
CZ : Dans notre travail, on essaie de questionner le positionnement de la femme, mais aussi de l’homme, parce que cela va ensemble. Il y a certains critères pour vraiment être considérée comme une femme. Si on ne les respecte pas, soit on n’est pas une femme, soit on est prise pour une folle. Est ce qu’une femme qui dit ouvertement qu’elle ne veut pas avoir d’enfants est totalement acceptée dans n’importe quelle société ? Jamais. Pourquoi elle ne voudrait pas d’enfants ? C’est une femme quand même, elle devrait en vouloir « normalement». Quand vous enlevez tous ces critères la femme évolue d’une tout autre façon, avec beaucoup de courage et sans peur.
GG : Ce sont des problématiques qui reviennent dans beaucoup de nos films. Ca va prendre des formes de questionnement sur l’identité sexuelle comme dans notre film Noor au Pakistan, ou sur le positionnement des femmes comme leader d’un groupe dans Sibel. De façon plus ou moins consciente, on traite aussi beaucoup de l’équilibre au sein du couple. Comment interagir et s’entraider, être solidaires l’un de l’autre ? Quels sont les rôles définis et les rôles à ne pas définir du tout ?
Propos recueillis par Léa Coupau et Camille Bernard