HC : Vous avez participé aujourd’hui à un forum organisé dans les locaux de la région Languedoc-Roussillon. Pensez-vous que vous puissiez rester indépendant en acceptant des aides de la région pour la production de certains films ?
PC : Oui, car ce n’est pas décisif dans la fabrication du film. Si on peut avoir des moyens supplémentaires pour faire des films indépendants, je n’y vois pas d’inconvénient. Ce qui est très important pour nous, c’est que ce soit fait de manière libre et indépendante, que la télévision n’ait pas son mot à dire. On a toujours proposé nos projets à Arte, ils n’en ont jamais voulu.
HC : Certains médias locaux qui s’entendent mal avec la région, comme l’Agglorieuse, n’ont pas pu venir.
PC : Je ne le savais pas. Pourquoi personne n’a dit ça dans la salle ? Il fallait le dire, il faut rebondir là-dessus.
HC : A l’époque de la sortie du PLPL (journal qui allait devenir Plan B, ndlr), est-ce que vous pensiez avoir la force de frappe nécessaire pour déstabiliser les médias dominants ?
PC : Ca ne se posait pas en ces termes. Mais il y avait une dynamique, une effervescence. Le bouquin de Bourdieu (Sur la télévision, ndlr) avait un très grand succès, comme celui de Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde. Les éditions Raisons d’agir démarraient très fort, comme mon film Pas vu pas pris. On était parti sur quelque chose qui avait une diffusion relativement large. On s’était dit : « On va foutre un sacré bordel et on va énerver vraiment ces puissants des médias », même si on n’était pas naïfs.
HC : Dans « Fin de concession », vous laissez sentir un certain désenchantement par rapport à vos premiers films. Pendant la conférence, vous avez dit qu’il fallait chercher de nouvelles techniques, chercher de la nouveauté.
PC : Ces gens là (« ces puissants des médias », ndlr), il faut vraiment leur taper dessus. Le fait qu’ils soient toujours à des postes importants, avec la capacité d’avoir ce pouvoir de nuisance qui est le leur, doit nous interpeler. Dix ans plus tard, ils sont toujours là et continuent de faire le sale boulot.
Il faut s’interroger sur l’efficacité des luttes, on est donc allé mener des actions au Dîner du siècle pour perturber ce dîner où se côtoient les élites médiatiques, économiques et politiques. On est aussi allé bomber le scooter de David Pujadas pour essayer d’inventer de nouvelles formes de contestation.
HC : Quelle est la portée d’une action comme le « dorage » du scooter de Pujadas ?
PC : Avant-hier il animait le débat des primaires socialistes donc on a échoué
quelque part. En même temps je pense qu’on a réussi à montrer David Pujadas autrement que selon l’image qu’il avait jusque là. J’ai entendu des gens à France Télévision qui disaient : « On sait pourquoi il est comme ça, il fait partie du dîner du siècle ».
En fait il a été repéré à Science-Po par Raymond Barre, il voulait l’embarquer dans son staff. Ils l’avaient déjà repéré comme de droite. Je crois d’ailleurs que c’est pour ça qu’il n’a pas porté plainte, parce qu’il s’est dit : « Je vais faire de la publicité à leur action, et je n’ai pas envie de me justifier sur le fait que je suis un laquais du pouvoir ». Donc on a quand même réussi quelque chose. Je pense qu’il y a eu quelque chose d’inquiétant pour lui dans cette action.
HC : Comment atteindre le grand public ?
PC : Les films qu’on a faits dans les années 90, les ouvrages, ont touché un public relativement large. 160 000 exemplaires d’un bouquin c’est un best-seller. Il y a eu une période pendant laquelle on n’était pas dans un cercle confidentiel. J’ai participé à des débats dans des salles de cinéma avec des centaines de personnes, j’ai vu des conférences de Halimi ou Bourdieu avec des milliers de personnes. Après on n’était pas invité non plus au JT de TF1 et nos analyses n’étaient pas connues de millions de personnes.
HC : Par quelles nouvelles techniques « désembourgeoiser » le mouvement contestataire ? N’êtes-vous pas trop ancré dans le schéma de « l’avant-garde » qui doit expliquer au peuple qu’il est manipulé ?
PC : Je n’ai pas de solution. Internet reproduit les mêmes inégalités, les mêmes hiérarchies…Ce n’est pas la panacée. Les mêmes rapports de force sont reproduits. Ce n’est pas parce que tout le monde peut créer son site qu’il aura la même visibilité que le site d’une grosse compagnie. Sur le papier, internet rend les choses démocratiques, mais il faut un certain capital scolaire ou culturel pour aller chercher l’information alternative, dissidente, critique, ce n’est pas à la portée de tout le monde. Exprimez-vous sur internet…
HC : Ce qui a été dit tout à l’heure, « la dictature c’est ferme ta gueule, la démocratie c’est cause toujours »…(Jean-Louis Barrault, ndlr)
PC : Ce n’est pas de moi, je n’ai rien inventé. Mais le « ferme ta gueule » fonctionne toujours. Il y a plein de choses qui sont interdites à la télévision.
HC : Quelle analyse avez-vous de l’information circulaire, de la « confraternité » que vous avez dénoncé, de l’incapacité de la télé à se critiquer elle-même ?
PC : On a vu qu’avec les primaires socialistes, la vie entière du pays tournée vers le fait de désigner untel plutôt qu’untel, pendant ce temps-là, on ne parle pas du social.
J’ai fait l’analyse d’un journal dans une fac à Angoulême. On a analysé le journal de 20h de TF1. il y avait 18 minutes sur les primaires socialistes, que des conflits de personnes, quasiment pas de programme, on voyait simplement qu’untel s’était fâché avec untel.
Après, un sujet sur les PV à Paris, alors « ce n’est pas bien car on a augmenté le taux de PV ». On arrive à la trentième minute, plein de gens allaient se retrouver cet hiver dans la rue, ça risquait de provoquer une catastrophe sociale.
Dans la hiérarchie de l’information, on voit ce qui préoccupe la télé, en exagérant les micro-différences de personnalité entre candidats d’une élection, en fabriquant la fiction d’un choix politique. A force de matraquer ça, les gens finissent par s’intéresser au match des primaires.
Donc, quand on fabrique un événement fabriqué de toutes pièces par ces médias, ça devient sujet de discussion, ça rentre dans l’espace public. Tout le monde fini par avoir un avis là-dessus, on se retrouve à ne pas s’intéresser à autre chose.
HC : Comment un média alternatif peut-il prétendre arriver à modifier les schémas de pensée ?
PC : Ils nous vendent et disséminent un mode de vie, le fait de chercher le bonheur à travers la consommation. Mais ils nous matraquent aussi sur l’absence d’utopie, c’est-à-dire sur le fait de nous résigner au fait qu’il n’y ait pas d’autre société possible que celle qu’ils nous présentent comme idéale et formidable, de ne pas imaginer qu’il puisse y en avoir d’autres.
Quand on a fait le film Volem rien foutre al pais, où on voit des gens vivre autrement, inventer des formes de microsociétés en rupture avec la société de consommation, ce ne sont pas des choses qu’on voit à la télé. Si on les voit à la télé c’est pour les marginaliser, les présenter comme des supers marginaux, comme des fous furieux.
Après, il n’existe pas de médias alternatifs. Il faut refuser ce mot car le mot alternatif voudrait dire qu’il y aurait une alternative aux grands médias, alors qu’elle n’existe pas aujourd’hui. Il n’y pas de médias alternatifs. Ce sont des médias indépendants, critiques, minoritaires, dissidents, hérétiques, mais ça ne constitue pas pour l’instant une alternative.
Il y a plein de choses en Amérique latine en ce moment qui sont intéressantes pour nous. Il faut inventer des choses dont on n’a pas idée aujourd’hui. Par exemple quand on crée C-P Productions, qui produit mes films avec Annie Gonzalez et une quinzaine de personnes, on invente un outil de production qui n’a pas d’équivalent en France.
François Ruffin, qui est passé par une école de journalisme, a inventé, avec ses copains, un journal indépendant sur Amiens, Fakir, qui a fini par devenir un journal national.
On peut entendre d’autres sons de cloches que ce que l’on entend habituellement. Il faut être inventif, il ne faut pas avoir peur, il faut faire les choses collectivement. C’est très important de s’inscrire dans une démarche collective, de travailler à plusieurs.
HC : Le problème principal pour une démarche de ce type c’est la contrainte économique…
PC : Oui, pour être indépendant il faut d’abord avoir une indépendance économique qui l’autorise. Si on veut travailler correctement sur des enquêtes, avoir du temps pour revenir sur les a priori de départ, en prenant du temps pour renverser des idées reçues, prendre le temps de douter, tout ce temps-là, c’est de l’argent. C’est le problème du format à la télévision, dans la presse. Les choses courtes sont superficielles en général.
C’est pour ça aussi que le journal XXI, créé par Laurent Beccaria, montre qu’on peut publier des articles très longs, qu’on peut faire des enquêtes en bande dessinée. C’est un média indépendant intéressant aussi, qui n’existait pas avant.
HC : La presse est une marchandise spécifique. Est-ce qu’on n’est pas dans un mécanisme d’innovation technique pour acquérir des parts de marché ?
PC : Quand on parle comme ça, c’est qu’on fait d’abord du commerce. Mais il ne faut pas être naïf. Même mes films font du spectacle, ils s’inscrivent dans une logique commerciale.
HC : Pierre Carles, merci.
crédit photo : Oscar Adrián Pineda Rojas


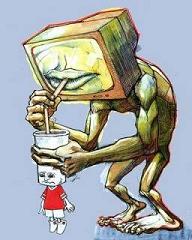
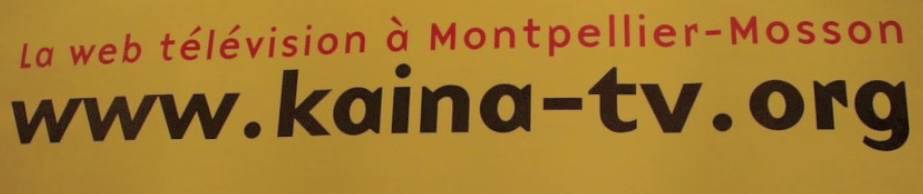


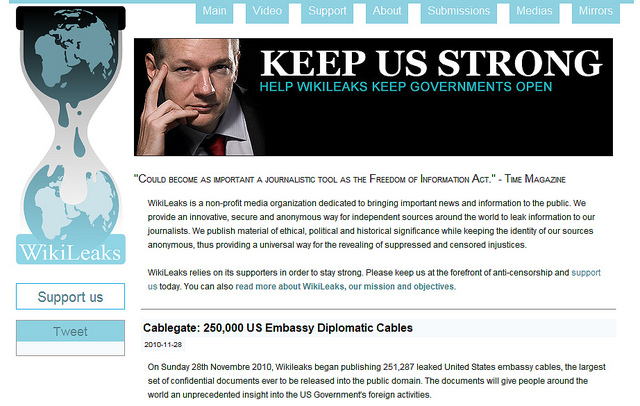
 Spécialiste des médias alternatifs aux États-Unis, Mathieu O’Neil est venu expliquer aux Montpelliérains cette révolution dans le monde de l’information. Cet universitaire australien a tenu à rappeler,
Spécialiste des médias alternatifs aux États-Unis, Mathieu O’Neil est venu expliquer aux Montpelliérains cette révolution dans le monde de l’information. Cet universitaire australien a tenu à rappeler, 



