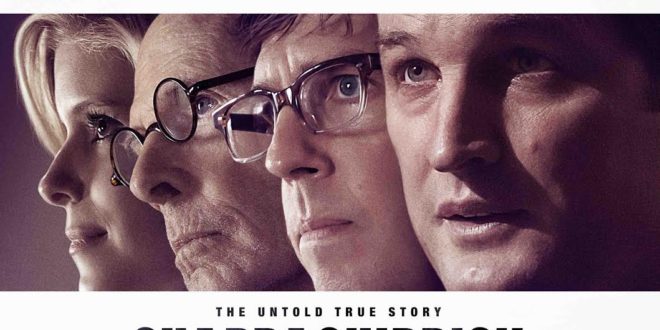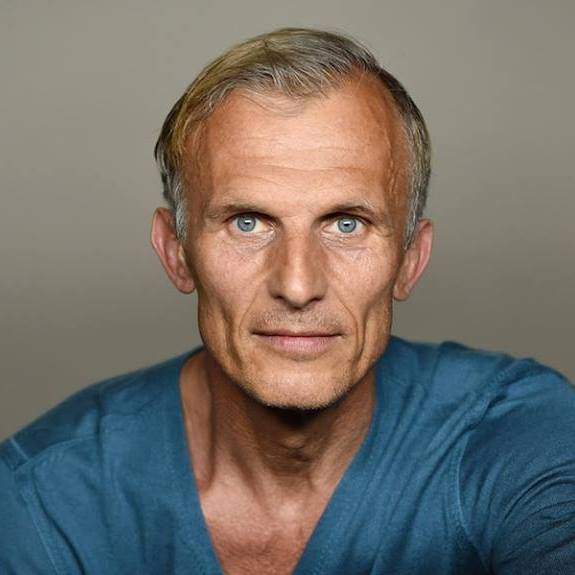Pourquoi avoir accepté d’être jurée au FIFP ?
Le documentaire est souvent politique, le voir traiter en fiction m’intéressait beaucoup. On observe que l’actualité des gilets jaunes se mêle à tout cela avec des tensions sociales brûlantes et palpables à tous les niveaux de la société. Les personnes qui m’ont contactée ont également évoqué des termes qui me parlent énormément comme l’envie de créer le débat, d’éveiller les consciences, de créer du lien social, être une passerelle de communication dans une époque où les intermédiaires et les lieux de débats n’existent plus vraiment. Les individus sont en train de se réapproprier cette question urgente du sens de l’existence. Qu’est-ce qui est acceptable ? Qu’est-ce qui ne l’est plus ? On est allé tellement loin dans les abus d’un capitalisme exacerbé, une mondialisation qui a été mal gérée, un appétit des élites pour le pouvoir qui a laissé de côté les questions sociales. On est dans une drôle d’époque pour tout ce qui a trait à l’humanisme.
Est-ce le devoir de l’artiste de s’engager ?
Je ne pense pas qu’il doive s’engager dans le sens du militantisme. Par contre son travail est par essence politique. L’artiste a un point de vue sur le monde, une sensibilité, un regard. Son devoir c’est d’éclairer différents mondes, de faire réfléchir sur une réalité en prenant de la distance. Il donne à voir et à comprendre ce que l’on n’a pas l’habitude de voir et d’entendre. Il rend palpables à travers des personnages ou des histoires des choses qui vont nous mettre en colère ou nous indigner. En tout cas, qui réveillent nos émotions.
En tant que jurée, quels sont vos critères de sélection d’un film ?
Pour moi le fond et la forme sont indissociables. Un bon film c’est l’adéquation parfaite entre son contenu et sa forme. Je regarde aussi d’autres facteurs comme l’interprétation, l’atmosphère du film, le rythme, la mise en scène, la lumière, l’audace du sujet et la manière de le traiter. Quand on arrive à avoir cette osmose là, à voyager à travers tous ces éléments, je trouve que c’est une grande réussite.
Envisagez-vous de réaliser une fiction ?
Non, parce que je n’ai pas le talent d’écrire une bonne fiction ou de diriger des acteurs. Le réel offre tellement d’histoires incroyables qu’il me suffit. J’aime le contact humain direct, les histoires que les gens me racontent, rendre la justesse du réel. Dans le documentaire, je travaille ma forme en cherchant à rendre le sujet palpable. Chaque projet a son écriture, une musique particulière, un rythme unique. Pour moi, le point de vue humain reste le sujet le plus intéressant, montrer les situations dans lesquelles l’être humain ne devrait pas se trouver. Je me spécialise aujourd’hui dans les zones de conflits. J’ai eu l’occasion de voir des populations ravagées au quotidien, la souffrance d’un peuple, les effets d’une guerre sur un individu.
Dans votre documentaire Donbass, y a-t-il des éléments que vous avez choisi de retirer en vous disant je ne peux pas montrer cela ?
Oui, la violence des corps. J’ai coupé les corps des enfants. Quand vous rentrez de zones comme celles-là, vous êtes révolté. Le premier réflexe, c’est de vouloir exposer un maximum de choses. Mais avec du recul, vous vous rendez compte que cela ne changera rien. Quand vous assistez à un bombardement, vous voulez montrer la souffrance des gens. Mais elle n’est pas efficace. La seule raison pour laquelle j’ai montré des corps au début du film, c’est pour contredire les discours du Président Porochenko qui affirme qu’il n’y a pas de morts au Donbass et qu’il ne bombarde pas son peuple. Encore aujourd’hui, j’ai eu des échanges avec des ambassades pour qui le discours officiel c’est qu’il n’y a pas de guerre au Donbass. Je voulais une preuve.
Avez-vous eu peur parfois lors du tournage ?
Non, parce que j’ai fait le choix d’y aller. J’en assume les conséquences. Quand ces gens vous parlent de leur quotidien, vous comprenez que ce que vous vivez un instant, eux, le vivent tous les jours. À ce moment-là, vous ne sentez plus la peur. Le corps humain est bien fait, il s’habitue à tous les stress possibles.
Ces violences ont des conséquences désastreuses sur les sociétés.
Ce type de conflit génère plusieurs générations de souffrance. Les stigmates, les plaies et les conséquences ne s’arrêtent pas à la fin de la guerre. Encore moins dans le cas d’une guerre civile comme le Donbass. Les gens deviennent paranoïaques. Ils ont vu leurs voisins trahir des gens qu’ils connaissaient depuis des années. Certains pardonnent, mais n’oublient pas. Comment voulez-vous que la société se reconstruise. Pour le Donbass, on parle de 10 000 morts mais c’est aussi 200 000 amputés. Quand tout s’est inversé dans votre vie, l’impensable devient normal, la charité n’existe plus. Cela va créer des individus qui n’auront plus foi en quoi que ce soit. Si on regarde les enfants nés sous la guerre, vont-ils réussir à se construire une conscience humaniste . Quand vous avez vu la haine partout dès vos plus jeunes années, vous y êtes habitué. Paradoxalement peut-être que vous en souffrez moins. Qu’est-ce que cela va laisser comme failles ? Quels individus de demain la société va voir fleurir ? La haine entretient la haine. On rentre dans des cycles de vengeance. Il y a beaucoup de probabilités que ces gens aient des pulsions destructrices en eux. On ne fait pas assez d’études sur l’après-conflit.
Comment avez-vous vécu votre retour en France ?
Il y avait une forme de décalage avec les gens autour de moi. En six mois, j’ai très peu parlé. Je ressentais beaucoup de colère, un sentiment de lassitude. Vous êtes un peu plus seul aussi. Cela change votre sensibilité. Vous sentez moins les problèmes du quotidien. J’avais tendance à relativiser énormément, à adopter un comportement plus désengagé dans ma vie de tous les jours.
Quels sont vos futurs projets ?
J’ai un projet sur les femmes prostituées du trafic humain en France. On n’a pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour trouver des horreurs aussi terribles que dans des zones de guerre. Pour moi le trafic humain, c’est un crime contre l’humanité. J’essaie de comprendre, la manière dont les individus arrivent à survivre dans les cas les plus terribles. Mon but est de rendre leur dignité et de montrer leur force. Ces personnes ont une philosophie quand vous les écoutez parler, c’est une grande leçon d’acceptation, de patience, et de bienveillance. Sans faire de généralités, les femmes prostituées que j’ai rencontrées ont une forme presque de pureté. Elles souffrent énormément, mais ne se plaignent pas. Elles sont dans l’idée : moi j’en suis sortie, maintenant je pense aux autres. Elles mettent une énergie incroyable pour dénoncer ces abus et risquent leur vie. Vous savez dans des milieux comme cela, on ne pardonne pas. Si vous balancez, on vous tire dessus.
Vous parlent-elles facilement ? Ne sont-elles pas méfiantes ?
J’ai le sentiment que quand vous n’êtes animé par aucun calcul autre que l’écoute, cela se ressent. Lorsque je vais sur le terrain, je n’ai pas de brassard presse, je ne mets pas de gilet pare-balles. Je vis avec la population, non dans les hôtels où logent les journalistes. Je traverse les zones avec eux dans leur voiture. Les gens voient bien que je ne suis pas là pour faire du scoop. Ces femmes me parlent parce que je vais rentrer sur ces zones de trafic avec elles. Il y a un partage du risque. Si cela se passe mal, on en fait les frais ensemble. Cela génère une confiance.
Comment souhaitez-vous le diffuser ?
Je recherche une maison de production qui soit respectueuse de la forme. Je suis en discussion avec Arte qui laisse une grande marge de manœuvre. Si la chaîne le prend, la question du cinéma ne se posera pas. Je préférerais ne pas passer à la TV que d’être diffusée avec un commentaire imposé irrespectueux du sujet pour garder l’audimat. Certaines situations fortes se suffisent à elle-même. Mais vous n’avez pas le droit au silence en TV.
Propos recueillis par Léa Coupau et Camille Bernard