« Nous sommes tous issus de la même lumière ». Une dédicace. Des mots qui touchent au cœur. Abd Al Malik, c’est ça. « Avec le cœur », une générosité, une émotion, un amour des mots. Un artiste qui garde le sourire et ne fait pas semblant. De Sénèque à Akhénaton en passant par Aimé Césaire et Jean Ferrat, son univers éclectique se dessine autour de philosophes, de rappeurs, de grands noms de la littérature et de chanteurs d’une autre décennie. « Un mélange de tradition et de modernité ». Pour lui, l’art a l’ambition d’universel.
Défaire les clichés et déconstruire les préjugés, voilà son maître mot. A ceux qui le voient tantôt comme un rappeur, tantôt comme un slammeur, tantôt comme un interprète de « chanson française de cité », il répond : « je suis un rappeur qui amène une singularité à mon art ». A ceux qui ne voient l’Islam que par le prisme de l’extrémisme, de la violence et de la burqa, il répond que lorsque l’on est dans une vraie démarche spirituelle, « on est dans le respect des lois du pays, dans le respect de tout être – homme et femme –, dans le respect de soi-même, on est dans l’écoute, dans le non-jugement, dans le dialogue… ». A ceux qui ne voient dans les banlieues qu’une bombe à retardement, il offre La guerre des banlieues n’aura pas lieu.
Une lettre ouverte à Éric Besson

Sorte de conte initiatique moderne qui présente un cheminement de vie et offre un état des lieux sur la France d’aujourd’hui, La guerre des banlieues n’aura pas lieu, c’est un peu le Mentir-vrai d’Aragon. Se servant d’un matériel autobiographique provenant de sa propre histoire, Abd Al Malik raconte des faits réels gardés dans sa mémoire pour une composition fictionnelle qui, bien que produit d’un mensonge et donc « menteuse », transporte une vérité qui s’approche plus de la réalité. Son objectif ? « Dire que nos élites politiques, culturelles et intellectuelles, sont de plus en plus déphasées avec la réalité, avec ce que l’on peut vivre, nous, dans la vraie vie. Il faut résorber le fossé entre les élites et nous le peuple. Il faut que l’on travaille à ce que la France soit à la hauteur d’elle-même. En termes d’idées et de principes philosophiques et fondateurs, la France est un pays merveilleux. Mais, les valeurs n’ont de sens qu’illustrées. Liberté, égalité, fraternité, richesse de la diversité, ces beaux principes n’ont de sens que s’ils sont actés. Sinon, c’est cruel, gravissime, presque criminel ». Un politique, comme un artiste, c’est quelqu’un qui devrait avoir « mal aux autres », dit-il en citant Jacques Brel.
Le poète réalise au fur et à mesure de son écriture que son livre est une véritable lettre ouverte à Éric Besson, une réponse au débat sur l’identité nationale. Qu’est-ce que l’identité française, et non nationale, pour lui ? « L’identité française, ce n’est pas une religion, une couleur de peau, c’est une communauté d’idées, une vision, un être au monde. C’est le rapport à l’universel, à la langue, à la singularité, à la culture. C’est ça que d’être français, et je suis fier et heureux d’être français. Il faut que l’on montre la richesse et la beauté de cette identité-là. Ce débat aurait pu créer du lien mais, maladroit et agressif, il a été mal mené. Conséquence : la montée du Front National et une désunion dans le pays. »
Et, face à un monde « incohérent » où les êtres sont « éclatés », il faut « travailler à être un, de l’intérieur ». Pour le poète, s’il est une chose fondamentale dans cette construction, c’est la cohérence : « ma cohérence est éthique, déontologique et morale, avec des valeurs. Sans être toutefois ni dans une démarche moralisatrice, ni une démarche dans le jugement d’autrui ».
Des mots qui dansent, une émotion passe. Questions à un poète.

« Les mots mènent aux actes […] Ils préparent l’âme, la mettent en condition, la poussent à la tendresse ». Sainte Thérèse d’Avila (citée par Abd Al Malik dans la préface de La guerre des banlieues n’aura pas lieu)
Pensez-vous que seuls les mots peuvent guérir les maux de la société ?
Bien sûr. Tout part de là, tout commence par les mots. « Au commencement était le Verbe » (nldr, Évangile selon Saint Jean). Autant, l’Histoire nous a montré que des horreurs ont trouvé leur origine dans les mots, autant les changements positifs trouvent aussi leur origine dans les mots. Alors, le verbe est soit porteur de vie, soit mortifère. C’est à nous de choisir.
D’où vient cet amour des mots ?
Gamin, j’étais dyslexique. Quand j’ai pu lire et écrire correctement, ça a été une bouée de sauvetage, puis un merveilleux véhicule pour voyager. C’est un monde qui s’est ouvert à moi. J’ai dévoré tous les bouquins, même si je ne comprenais pas tout ce que je lisais. Très tôt j’ai été introduit à de grands auteurs. Et, petit à petit, ces auteurs sont devenus des amis. Des amis qui, peu à peu, m’ont poussé à l’écriture.
J’ai une vie livresque très riche. Mais, s’il y a une chose que tous ces auteurs m’apprennent, c’est que le plus important n’est pas dans les livres. Le plus important est dans la vie. Les livres ne sont qu’un prétexte pour faire du lien, pour comprendre que l’on doit partager avec les gens, que l’on doit vivre les choses. L’essentiel se vit. Lisez, puis fermez les livres et vivez.
Que pensez-vous de l’adage « le poids des mots, le choc des photos » ?
J’aimerai que l’on aille plus loin. Un être, ce n’est pas qu’une photographie. Les gens sont faits de chair et de sang, ils ont des espoirs, des craintes, des peurs, des joies. Les mots aident à décrypter, à décrire un monde intérieur, à communiquer, à échanger avec les autres. Par contre, il faut se méfier des images. C’est une réalité figée dans le temps et dans l’espace. Or, il y a des choses qui se passent en annexe, avant et après.
Pensez-vous qu’un mot peut tuer ?
Bien sûr. Parfois, on dit des choses abruptes, comme ça, sans se rendre compte et ça peut tuer. Les mots peuvent empêcher l’espoir, la possibilité de transcender une condition et peuvent être porteurs d’enfermement. C’est pour cela qu’il faut faire très attention aux mots que l’on emploie.
Vous vous dites patriote. C’est dans une démarche patriote que vous avez écrit ce livre ?
Ma démarche artistique, musicale ou littéraire, est souvent faite dans une démarche patriotique. Un patriotisme au sens de Sartre, de Camus : dire qu’il y a des valeurs avec lesquelles on ne doit pas transiger. Des valeurs que l’on doit porter, défendre, envers et contre tout.
Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous ?
D’abord, les valeurs fondatrices de ce pays : la liberté, l’égalité, la fraternité, l’universel. Puis, le respect de l’autre dans la différence, la solidarité, le fait de pouvoir transcender sa condition par le savoir et devenir quelqu’un alors que l’on vient de nulle part. Ce sont des valeurs ancrées à l’Histoire de ce pays. Des gens se sont battus, sont morts pour ça.
Dans C’est du lourd, vous dites « quand tu insultes ton pays, tu t’insultes toi-même », à qui est adressé ce message ?
A nous tous. Beaucoup ont pensé que je m’adressais uniquement aux jeunes des cités. Bien sûr, cela les concerne. Mais, cela concerne aussi les politiques et les élites en général. Dont des intellectuels qui ne voient que des choses négatives, qui refusent de voir que la diversité est une chance ou d’admettre que l’immigration a toujours été source de richesses. C’est aussi insulter son pays. Il est facile de dire : « regardez rien ne fonctionne ». Tout le monde peut le faire. Mais se dire « c’est vrai que c’est difficile, mais soyons ceux qui allumons les bougies de l’espoir, au lieu de constater et de rester dans l’obscurité » est autrement plus enrichissant.
Pourquoi cette référence à La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux ?
D’abord pour m’inscrire dans un acte littéraire. Puis, je trouvais ça fort, le fait que personne ne veut la guerre mais que des fois on agit de manière inéluctable vers elle. La possibilité de ne pas faire la guerre est dans nos mains à tous, pour peu que l’on s’en donne les moyens, que l’on évoque et que l’on invoque la paix. Dire que la guerre des banlieues n’aura pas lieu, c’est une ligne de mire, c’est dire : « on va faire en sorte qu’elle n’ait pas lieu ».
Vous parlez souvent de spiritualité, comment la vivez-vous quotidiennement ?
Je la vis au travers de l’Islam. Je suis musulman pratiquant. Mais, la spiritualité embrasse toute chose. On peut ne pas croire en Dieu et être profondément spirituel. La spiritualité est un être au monde. C’est une capacité à partager avec les autres, à comprendre que notre destin à tous est lié.
Êtes-vous un optimiste ou un idéaliste ?
Les deux. Optimiste, c’est voir le verre à moitié plein. Idéaliste, c’est avoir un idéal. Le fait de rêver, d’avoir des utopies, de voir les choses de façon positive, permet de travailler à rendre nos rêves réels. Je ne suis pas « cuicui les petits oiseaux », je ne nie pas les problèmes que l’on traverse. Mais, ma démarche est authentiquement positive. Mon idée est de donner de l’espoir.
Pour finir, pensez-vous que tout ne passe que dans l’émotion que suscite les mots ?
Dans l’émotion, il n’y a ni couleur, ni sexe, ni âge, ni milieu socioculturel. Il y a juste des hommes et des femmes avec un même cœur qui bat.
Julie DERACHE




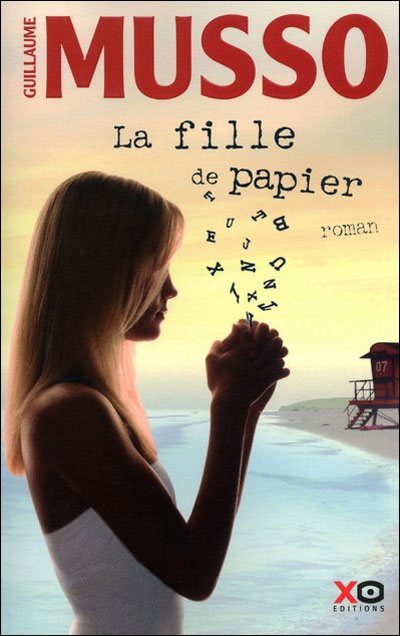





 Certains livres se suffisent à eux-mêmes. Le dernier opus d’Olivier Adam fait déjà parler de lui dans tous les médias. Paru aux éditions de L’olivier, « Des vents contraires » permet à l’auteur de « Je vais bien, ne t’en fait pas » de revenir sur les côtes bretonnes qu’il affectionne tant. On y suit le parcours d’un écrivain qui perd l’inspiration après le départ inexpliqué de sa femme. Ou encore cette petite nouvelle, mise en évidence sur les tables de la librairie Sauramps: « Mon voisin » de Milena Agus, poids plume de quelques millimètres vendu 3 euros. Une petite douceur qui a coup sûr, fera recette. Une femme, sarde comme l’auteur, songe pendant ses chaudes après-midi, à la meilleure manière de se suicider. Et ce jusqu’à ce qu’elle découvre dans les yeux de son voisin, des raisons de mourir un peu moins vite…
Certains livres se suffisent à eux-mêmes. Le dernier opus d’Olivier Adam fait déjà parler de lui dans tous les médias. Paru aux éditions de L’olivier, « Des vents contraires » permet à l’auteur de « Je vais bien, ne t’en fait pas » de revenir sur les côtes bretonnes qu’il affectionne tant. On y suit le parcours d’un écrivain qui perd l’inspiration après le départ inexpliqué de sa femme. Ou encore cette petite nouvelle, mise en évidence sur les tables de la librairie Sauramps: « Mon voisin » de Milena Agus, poids plume de quelques millimètres vendu 3 euros. Une petite douceur qui a coup sûr, fera recette. Une femme, sarde comme l’auteur, songe pendant ses chaudes après-midi, à la meilleure manière de se suicider. Et ce jusqu’à ce qu’elle découvre dans les yeux de son voisin, des raisons de mourir un peu moins vite…

